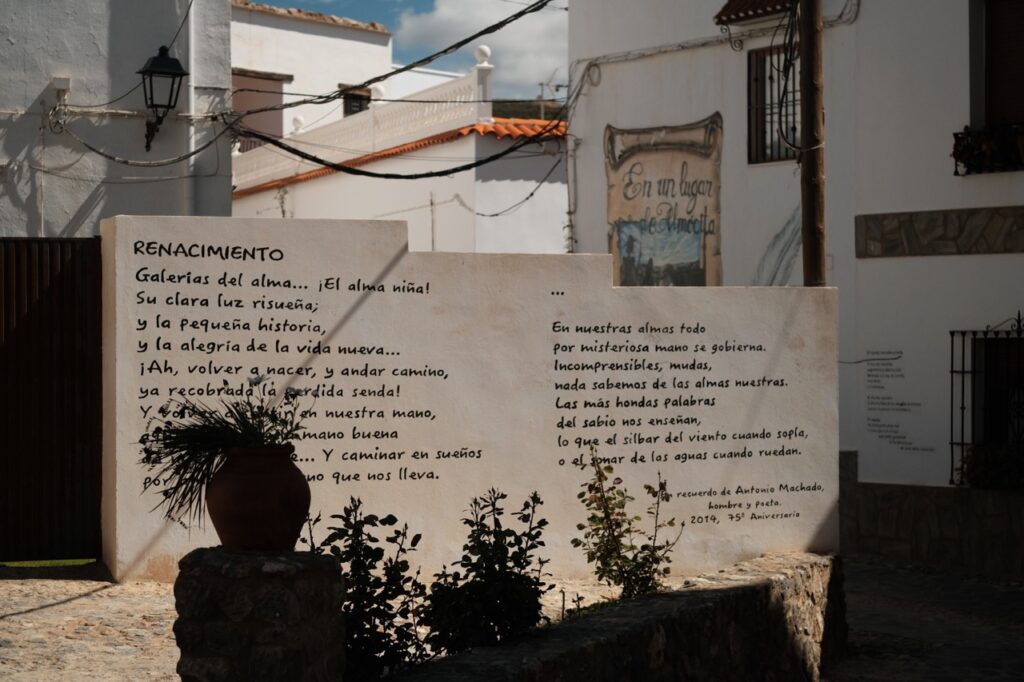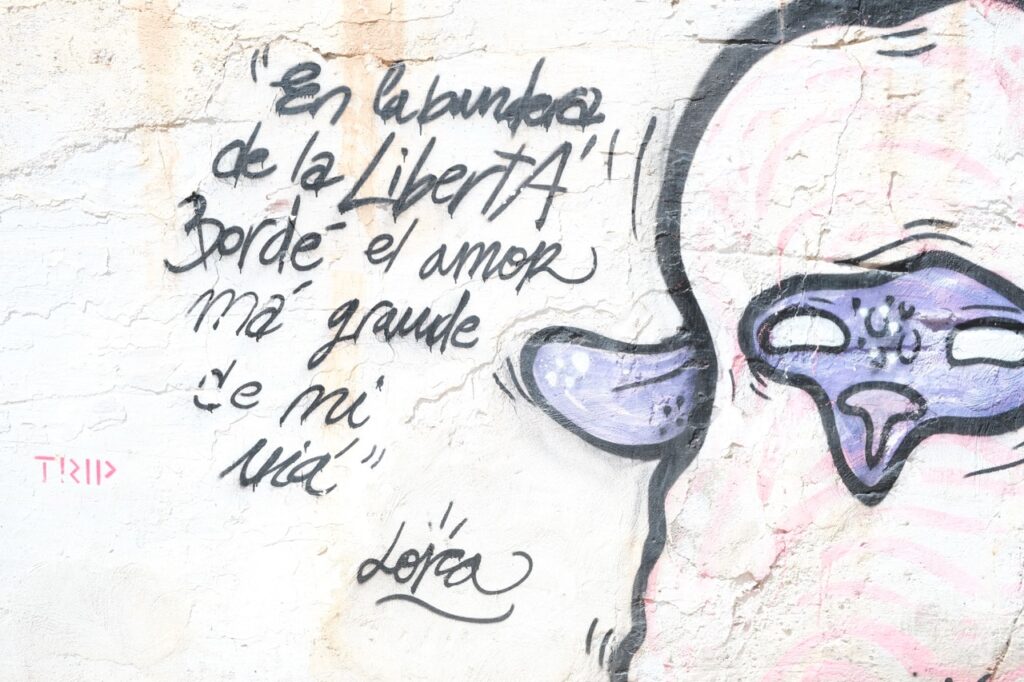Robinsonade
À Tijuana, Edgar nous avait prévenu : le désert est une expérience intérieure, presque spirituelle. Dans Robinson et les limbes du Pacifique, le personnage principal seul sur une île désapprend petit à petit les codes de la société pour atteindre un état d’éveil et de contemplation en parfaite harmonie avec son environnement. Cette traversée de la Basse-Californie nous a fait entrapercevoir toute la puissance mystique du désert : comme le Robinson Crusoé de Fournier, nous avons dans un premier temps souffert de la monotonie et tenté de nous raccrocher à notre civilisation. Pour nous cela passe par les arrêts wifi dans les restaurants routiers, qui nous permettent de communiquer avec nos lointains proches.
Les horaires et calendriers ne sont que des conventions sociales, qui n’ont plus de sens lorsque l’on est seul. Petit à petit nous avons commencé à perdre le compte des jours et des heures et à vivre uniquement au rythme du soleil. À tel point que nous nous sommes rendus compte seulement plusieurs jours après avoir changé d’Etat que nous avions également changé de fuseau horaire.




Lorsque nous traversons le bassin de Vizcaino, la route devient désespérément rectiligne et plate, à travers une végétation monotone. Quand le regard n’est plus stimulé, il se tourne vers l’intérieur. Dans ce genre de situation je m’enferme dans une sorte de bulle de méditation. Je ne pense à rien d’autre qu’à avancer à un rythme plutôt soutenu, qui me permet de me maintenir dans cet état. Chaque stimulation qui m’oblige à changer mon rythme ou à porter mon attention sur l’extérieur me fait sortir de ma bulle et me fatigue nerveusement. Une voiture qui passe un peu trop près, le vent de face qui ne me permet pas d’atteindre ma « vitesse de méditation » ou Elisa, beaucoup moins rapide que moi mais que je ne veux pas perdre de vue, ce qui m’oblige à m’arrêter trop souvent. À la longue je finis par exploser et je deviens insupportable. 40 jours dans le désert, quand on n’est pas Jésus, Mohammed, ou Bouddha, c’est long ! Nous avions déjà vécu cette situation dans le nord du Canada. J’aimerais aller au bout de cette expérience un jour, mais je crois que cela ne peut se faire que seul.
Heureusement, lorsque nous sortons des routes, notre attention est entièrement absorbée par notre environnement. La beauté des paysages, la faune et la flore qui nous entourent nous remplissent de joie. Si le bitume matérialise une barrière entre nous et la nature, ce n’est plus le cas sur une étroite piste de terre sans aucun traffic, où nous zigzaguons à travers les plantes. Les animaux, ne risquant pas de se faire tuer par une voiture lancée plein pot dans un bruit effrayant sont beaucoup moins craintifs, plus nombreux et nous laissent les admirer plus facilement. La difficulté de la progression nous oblige également à ralentir, à faire plus de pauses et nous vide complètement physiquement. La Baja Divide est une route particulièrement belle qui se mérite. Sur cet itinéraire, la magie du désert opère puissance mille. La beauté grandiose des journées solitaires laisse la place aux soirées et aux nuits époustouflantes. L’absence de Lune lors de notre traversée nous offre des ciels noirs remplis d’étoiles, qui succèdent à des couchers de soleil à tomber par terre. Si visuellement c’est une claque, les sensations sonores sont encore plus fortes. Quoi de plus intense que de dormir dans le silence total du désert ou bercé par le ronronnement du ressac du Pacifique, et d’être réveillé au petit matin par le bourdonnement des colibris plutôt que par le rugissement des camions ?









À Ciudad Constitucion, nous retrouvons Oscar, que nous avions croisé plusieurs mois plus tôt au Yukon. Avec son crâne entièrement rasé, son calme imperturbable et le bouquin de Matthieu Ricard sur la méditation qu’il nous offre, on croirait presque un moine bouddhiste en mission. Nous décidons de terminer la route ensemble jusqu’à La Paz, où nous prendrons le ferry pour le continent. Oscar, finisher d’Ironman, est beaucoup plus rapide que nous et fait de plus longues journées. Pour nous c’est un challenge d’essayer de le suivre. Dès le deuxième jour, nous sommes épuisés. Mais nous découvrons que dans la fatigue, nos corps s’habituent et trouvent leur rythme. Si nous ne sommes plus en mesure de passer une bosse en force, nous pouvons continuer à rouler à un rythme plus tranquille sans difficulté. Chaque soir, nous sommes épuisés et nous nous endormons profondément. Chaque matin et après chaque pause, nous sentons que nos corps commencent à récupérer. Expérience intéressante et complémentaire de celle de la solitude du désert, qui éveille mon intérêt pour un bikepacking plus sportif que je ne pensais pas fait pour moi.
Un peu d’histoire
La colonisation de la péninsule est récente. Les premiers colons espagnoles furent des missionnaires catholiques, arrivés à partir du 18e siècle, suivis par des éleveurs puis des investisseurs étrangers intéressés par les ressources naturelles : métaux et poisson notamment. Aujourd’hui, le pillage de la nature est toujours le moteur de l’économie locale. Mines, exportation de homards et poissons vers la Chine, tours en véhicules tout terrain dans des environnements fragiles, harcèlement des baleines qui viennent se reproduire en mer de Cortez pour des touristes qui veulent s’approcher suffisamment près pour les toucher…






Cette colonisation a commencé par le sud, puis s’est étendue petit à petit vers le nord. Si bien que plus nous avançons et plus l’architecture est ancienne et les villages et ranchs nombreux. Santa Rosalía, ville minière fondée par l’entreprise française du Boléo, se distingue par son architecture qui évoque la Louisiane ou les DOM-TOM et son église conçue par Eiffel. Les oasis de Mulegé et San Ignacio par leurs rues tortueuses et leur architecture baroque typiquement espagnole. Et les villes agricoles poussées comme des champignons lors des 50 dernières années déploient leurs larges rues quadrillées adaptées à la voiture de part et d’autre de la Ruta 1.




Cowboys
Sur les highways, les cowboys sont ces touristes au volant de leurs énormes camping-cars qui conduisent leur véhicule comme si c’était une arme. Lancés pleine balle, ils roulent comme s’ils étaient seuls sur la route et reprochent aux cyclistes de les mettre en danger. Ces fous sont terrifiés à l’idée de se faire braquer et exhibent tous leurs jouets à plusieurs centaines de milliers de dollars : énorme 4×4 tractant un encore plus gros camping car, auquel sont parfois attachés un bateau et un véhicule tout terrain. Comme leurs ancêtres à la conquête de l’ouest, ils se regroupent en caravane et envahissent les endroits qui leur plaisent, sans considération pour la nature des lieux. Après tout ils apportent de l’argent, alors ils peuvent bien se permettre de garer leurs énormes maisons de plastique et d’aluminium sur les plus belles plages, au ras des flots. N’avoir que trois pas à faire entre le frigo et les pieds dans l’eau, une certaine idée de la liberté. Heureusement certains relèvent le niveau, nous dépassent très respectueusement en nous faisant de grands signes amicaux, nous offrent de l’eau et même des bières. Nous avons même croisé des américains en Prius avec une tente… Espèce très rare à protéger !






Sur les pistes de terre et de sable, les cowboys sont d’authentique vaqueros, portant moustache, santiags et stetson. Perchés sur leurs chevaux, lasso à la main, ils parcourent l’immense territoire de leur ranch pour surveiller le bétail et protéger chèvres et vaches des coyotes. Si le vieux pickup Ford rouillé et grinçant a remplacé la charrette, leur uniforme comme leur métier ont très peu changé depuis que leurs ancêtres sont arrivés dans ce désert. Lors des grandes occasions, ils se réunissent pour une cabalgata, une chevauchée. Fiers et amicaux, ils s’arrêtent toujours pour discuter et nous inviter à camper sur leurs terres. Muy feo répondent-ils quand nous leur demandons comment est la route plus loin. Ils savent de quoi ils parlent : vissés à leur destrier, ils vivent au même rythme lent que nous sur nos vélos et font face aux mêmes obstacles, bien que leurs montures soient plus adaptées à cet environnement que les nôtres. Ces cowboys ci ont tout mon respect. Ils vivent une vie rude et austère mais leur bienveillance est infinie comme le désert.