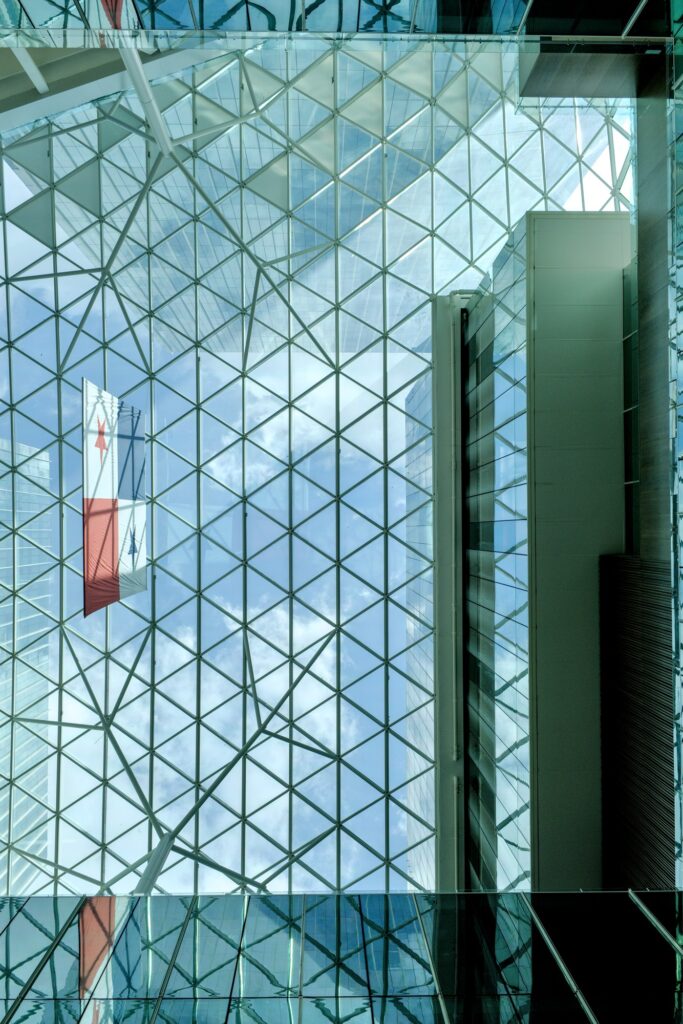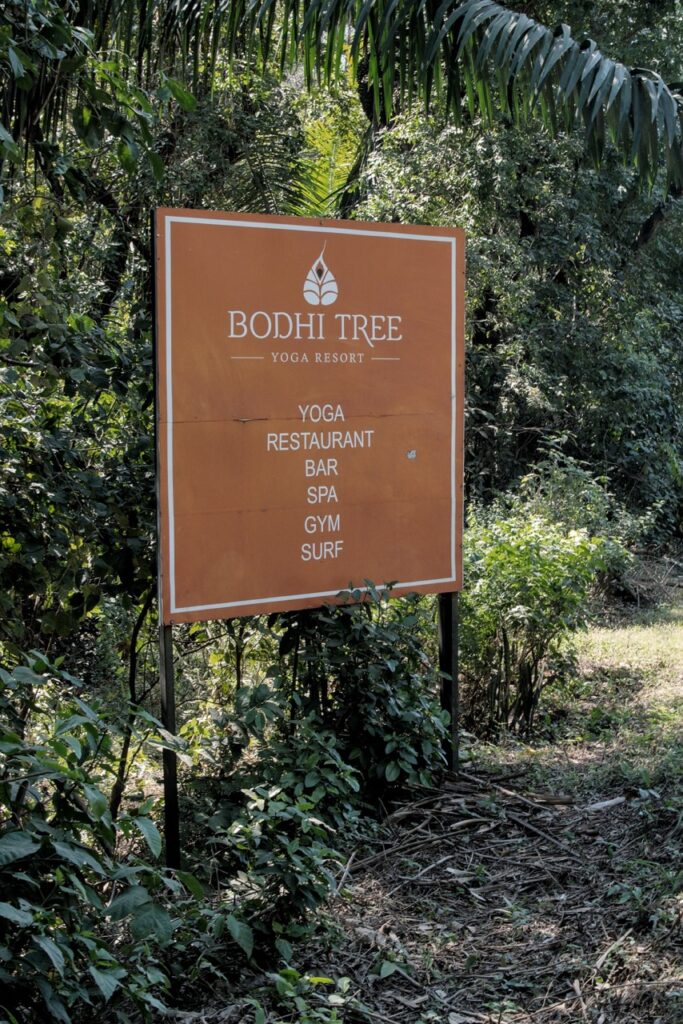Nous sommes arrivés sur le continent sud-américain le 31 janvier 2024. Après un mois compliqué où les galères et les mauvaises nouvelles se sont enchainées, nous n’avons pratiquement pas pu rouler un seul kilomètre et, par conséquent, notre budget s’est envolé. Arrivés à Bogota, nous espérions avoir enfin conjuré le sort et reprendre la route sereinement. Nous ne le savions pas encore, mais le bout du tunnel était encore loin. Nos vélos étant un peu fatigués après plusieurs mois de chaleur humide et d’air salé en Amérique centrale, nous les avons confié à un atelier pour un changement des roulements de direction d’Elisa, de mes roulements de moyeu avant et de mon boitier de pédalier. Une petite révision de routine en somme. Malheureusement, le technicien a qui nous avons fait confiance a pris la liberté d’ouvrir le moyeu Rohloff d’Elisa sans savoir ce qu’il faisait, l’a détruit et nous a rendu le vélo l’air de rien, en essayant de camoufler les dégâts.
Les moyeux du fabricant allemand Rohloff sont un peu la montre suisse du vélo de voyage : précis, complexes, increvables… et chers. À elle seule, cette pièce coûte presque autant que le reste du vélo. C’est un investissement que nous avons choisi de faire pour plusieurs raisons : il permet de se libérer du dérailleur, partie fragile (notamment sur les chemins boueux ou caillouteux, ou lorsque l’on charge le vélo dans un bus ou un camion), de limiter l’entretien au strict minimum (plus de galets de dérailleurs à démonter, plus de crasse difficile d’accès entre les pignons de la cassette…) et d’avoir une transmission très durable (ces moyeux sont théoriquement capables de durer une vie entière de voyageur à vélo et se bonifient avec l’âge, contrairement aux transmissions classiques « jetables »). Le seul inconvénient : comme toute mécanique complexe, en cas de problème, tout est compliqué. Mais en théorie, il n’y a pas de problème. Sauf lorsqu’une intervention humaine le provoque… Nous restons convaincus que cet investissement est rentable sur le long terme comparé à une transmission plus classique et nous referions ce choix sans hésiter, mais à l’avenir nous serons plus prudents lorsqu’il s’agira de confier nos vélos à quelqu’un.
Après quelques échanges de mails avec Rohloff, le problème est rapidement identifié et le verdict tombe : les réparations nécessaires sont trop complexes, il faut envoyer la roue entière à un centre de réparation agréé. Le plus proche, Teutobike, est à Porto Alegre, au sud du Brésil, à 4800km à vol d’oiseau de Bogota. Au-delà des Andes, au-delà de l’Amazonie, à l’autre bout du plus grand pays d’Amérique Latine. Autant dire au bout du monde. D’après Klaus, le propriétaire de Teutobike, envoyer la roue depuis la Colombie vers le Brésil, puis à nouveau vers la Colombie est trop risqué : deux douanes à passer, des taxes à payer et le risque que la roue reste bloquée d’un côté ou de l’autre de la frontière. Pas le choix : nous devons aller au Brésil. Sur le moment c’est un véritable coup dur : notre budget, déjà entamé par le mois sédentaire qui vient de s’écouler, va être encore plus creusé par les réparations et le détour. Après tout ce que nous avons déjà subi depuis la blessure d’Elisa au Costa Rica, j’ai le moral dans le chaussettes. Je n’ai plus la force mentale de continuer, juste envie de rentrer en France, mettre fin à ce voyage qui me semble maintenant absurde et retrouver ma famille, mes amis et une vie stable. Ce qui me convainc de continuer, c’est la raison : nous avions pris un peu d’avance en Amérique centrale, ce qui nous permet, malgré ces contretemps, d’avoir encore la possibilité de traverser le continent en passant à la bonne saison les points critiques (hauts cols andins, salar d’Uyuni, Patagonie…), qui ne sont franchissables à vélo que quelques mois par an. Si nous rentrons maintenant, cette opportunité ne se reproduira probablement jamais. Ce serait vraiment dommage de faire une croix sur cette partie du voyage, qui promet à la fois des opportunités de camping sauvage dans des paysages grandioses, des routes intéressantes et des détours qui pourraient être l’objet d’un voyage à eux seuls. Depuis deux ans, l’Amérique du Sud est le véritable objectif, le reste n’étant qu’une sorte de long échauffement.
La solution la plus économique que nous trouvons consiste à nous rendre à Leticia, capitale de l’Amazonie colombienne, où nous pourrons embarquer sur un des bateaux qui transportent passagers et marchandises sur le fleuve Amazone, véritable autoroute fluviale de 3700km desservant 3 pays et plusieurs millions d’habitants, d’Iquitos au Pérou à Belem sur la côte brésilienne. Nous descendrons à Manaus, ville de 2,5 millions d’habitants en plein coeur de l’Amazonie, où nous enverrons la roue par la poste à Klaus, qui nous la renverra une fois les réparations terminées. Le plan est ficelé, ne reste plus qu’à le réaliser !

La suite dans le prochain article !